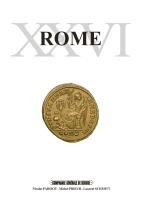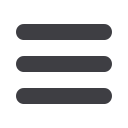

- 19 -
Soldat ou Constantin I
er
debout à droite, tête nue, vêtu
militairement, tenant une haste renversée de la main droite et
appuyé de la gauche sur son bouclier.
La typologie de ce revers est classique : représentation dun soldat
ou de lempereur vêtu militairement afin dexalter la « Virtus » de
lempereur. Lempereur, chef des armées en est le symbole et le
représentant. Le personnage est vu de face tourné à gauche (jambe),
mais la tête tournée à droite. Il est dans une attitude dattente, de
réserve et de gardien, tenant la lance renversée de la main droite et
sappuyant de la main gauche sur son bouclier.
Victoria (la Victoire) assise à droite sur un cippe tournée à gauche,
tournant la tête à droite, tenant une palme de la main gauche ;
devant elle à gauche, un trophée et un captif agenouillé à gauche
sur lequel elle pose son pied droit ; au-dessous, un bouclier.
Ce type nest pas nouveau avec la Victoire associée au trophée et au
captif vaincu agenouillé. Cest lassociation bien particulière avec
cette légende qui en fait la spécificité. Ce revers, à lui seul symbolise
le nouvel atelier Ce type, le seul utilisé par Constantin Ier à partir de
la quatrième émission et de 328 marque un tournant dans le
monnayage constantinopolitain. Il ne peut pas seulement symboliser
une victoire sur le front danubien, si importante fut-elle. Ce revers
associé à la légende, présente Constantin comme le garant de la
Sécurité de lempire, le rempart contre la danger extérieur. À ce titre,
il sinscrit dans les choix iconographiques de la première moitié du
IVe siècle.
En examinant le monnayage de Constantinople, nous nous rendons
très bien compte quau moment de louverture de latelier en 326, le destin de la ville nest pas scellé. Entre 326
et la réforme de 330, nous avons trois changements majeurs iconographiques pour les revers et une variété de bustes
diadémés qui ne se retrouve dans aucun autre atelier sur une période aussi courte. En 326, quand latelier ouvre
ses portes, rien ne le distingue des autres ateliers, en particulier orientaux qui fonctionnent depuis la réunification
de lempire deux ans plus tôt. Un changement important se produit à la fin de la première émission, une rupture
iconographique qui saccompagne peut-être de choix idéologiques et politiques que traduisent ladoption de
quatre nouveaux types avec des légendes qui peuvent constituer les bases dun programme philosophique au
moment où Constantin pense à transférer la capitale de lEmpire pour la ville quil a choisi, à quil donne son nom
et quil dote dinstitutions comparables à lUrbs en faisant son égale, créant ainsi un dualisme jusque là inusité.
Cette première rupture saccompagne dun re-centrage autour dun thème unique à partir de la quatrième émission
où le message politique et iconographique de départ se trouve relégué en arrière plan tandis que lempereur est mis
en avant par le choix de nouveaux types de bustes, idéalisés, marquant une rupture consommée avec les canons de
lart antique (gréco-romain) et marquant la naissance de lart byzantin ou chrétien.
Les choix iconographiques de représentation sont peut-être le début dexplication auquel tous les auteurs depuis
un siècle ont essayé sinon de répondre, dapporter sur la vision dun monde qui était en train de changer et où
lempereur nétait plus un dieu parmi les dieux, mais un homme inscrit dans la cosmologie divine où le principe
du fils de même nature que le Père et le Saint-Esprit, principe adopté au Concile de Nicée heurtait la conception
de certains intellectuels orientaux qui préféraient voir le fils subordonné au père (lhomonoia des Grecs) symbole
dune nouvelle vision du monde où il ny avait plus de place pour lhomme seul !
Laurent Schmitt (ADR. 007)
n°
210967
R/
n°
210967
R/