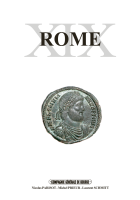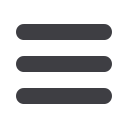

- 15 -
LEMONNAYAGE DE BRONZE ET LARÉFORMEMONÉTAIRE
Au regard du règne de Julien, assez long (355-363), le monnayage est peu abondant. Il convient de partager le règne entre
les espèces du César Julien, entre 355 et 360, et celles de Julien Auguste à partir de 360. Même pour cette seconde partie
du règne, une distinction simpose pour le monnayage. Julien nobtient le contrôle total des ateliers monétaires quaprès
la mort de son cousin Constance II, le 3 novembre 361. Julien fait son entrée dans Constantinople le 11 décembre 361. Il
entame les grandes réformes à partir du début de lannée 362, dabord à Constantinople, puis ensuite à partir dAntioche,
de juin 362 à son départ pour la campagne persique en mars 363. Lévénement numismatiquement important est la célébra-
tion anticipée des decennalia (dixième anniversaire de règne) qui débute à lautomne 362, normalement à partir du 6
novembre.
Déjà, dès 1960, les auteurs du «
Late Bronze Roman Coinage
»
op. cit.p. 42, notaient quune nouvelle légende monétaire fait
son apparition début 363 (janvier) avec la forme : D N FL CL
IVLIANVS P FAVG. Pour R. A. G. Carson et J. P. C. Kent, toutes
les monnaies avec le buste barbu et les deux types de revers «
Securitas Reipub » et « Vot X Mult XX » ne pouvaient être an-
térieures à cette date. Une vision toute différente avait été propo-
sée par Ernest Babelon dans un article de la Revue Numismati-
que resté célèbre : « LIconographie monétaire de Julien lApos-
tat »,
RN
. 1903, p. 3-36, pl. VII-X où lauteur tendait à démontrer
quune évolution stylistique était notable en fonction des ate-
liers en particulier pour ceux de Constantinople et dAntioche.
J. P. C. Kent a nuancé son point de vue dans le RIC VIII, op. Cit. p. 46-47, en faisant remarquer que la nouvelle titulature
longue de Julien était déjà utilisée à Cyzique dès la fin de lannée 361, au moment où Julien récupère lensemble des
prérogatives de Constance II. Si tous les auteurs semblent saccorder sur le fait que lensemble du monnayage dor de
Julien sarrête au début de lannée 363 après la commémoration des decennalia anticipées et la distribution despèces à
cette occasion, à la fin de lannée 362, le mystère autour du monnayage de bronze et de sa réforme reste entier.
La première hypothèse est de faire débuter les émissions au début du règne personnel de Julien, cest-à-dire de la fin de
lannée 361, après son entrée à Constantinople ou tout du moins au début de lannée suivante. Faut-il rappeler un trait
important de la physionomie de Julien. Il décide de ne plus se raser après son entrée dans la Capitale en décembre. Tous les
empereurs depuis Constantin étaient glabres. Ce retour à la barbe, qui plus est celle des philosophes, fut largement criti-
quée, voire raillée. Julien sen défendit, en particulier auprès des habitants dAntioche et leur répondit dans le Misopogon :
«
Vous dites quil en faudrait faire des cordes, jy consens volontiers, pourvu que vous parveniez à larracher et que sa
rudesse ne fasse pas trop de mal à vos mains tendres et délicates. Ne vous imaginez pas que je sois chagriné de vos
railleries : je leur donne prise moi-même avec ma barbiche de bouc
. » Julien,
Misopogon
, ch. 2
Ernest Babelon, encore lui, en sappuyant sur ce texte et le fait
quil a été rédigé à Antioche avant le départ de lempereur
pour la campagne persique et que Julien a séjourné près de
huit mois dans la capitale provinciale située sur lOronte,
pensait démontrer que les produits de latelier dAntioche
pouvaient laisser entrevoir des évolutions stylistiques entre
les mois de mai/juin 362, marquant larrivée de lempereur et
le mois de mars 363, date de son départ (E. Babelon, RN. 1903,
p. 18-20, pl. VIII). Pour Ernest Babelon, une évolution était
notable et semblait marquer le renforcement et la longueur de
cette barbe. Daprès J. P. C. Kent, pour Antioche, nous pou-
vons déterminer quatre séquences démission différentes en
fonction des marques dexergue (RIC. VIII, op. cit., p. 531-
532) ce qui ne semble pas létendue la plus importante car nous en rencontrons jusquà cinq pour Constantinople, mais
aussi huit pour Siscia, sept pour Nicomédie et quand même cinq pour Arles, atelier occidental très éloigné de latelier de
Syrie. Si les marques dexergue sont un moyen de dater les monnaies et les phases démissions, notre tache va être encore
plus complexe si elle doit être combinée avec létude iconographique des bustes.
Dautre part, dans le cadre de la réduction drastique du nombre des officines, opération qui était datée de 363 par les auteurs
du LRBC, Siscia semble être le seul atelier dont les espèces de la réforme sont connues avec dabord quatre, puis deux
officines ce qui semblerait infirmer que la réforme monétaire précéderait la réforme des ateliers et la réduction des officines.
Il semble en être de même pour latelier dAquilée, de manière moins appuyée.
Le tableau détaillé des émissions pourrait permettre démettre des hypothèses. En nous appuyant sur les travaux de Jean-
Pierre Callu, qui en 1986, lors du colloque de Paris, avait essayé de présenter et détayer une théorie sur une rationalisa-
tion de la production des monnaies de bronze pour la période valentinienne, il avait déterminé à partir de létude des
marques datelier et dofficines la théorie du rythme trimestriel des émissions monétaires. Plus que la périodicité (men-